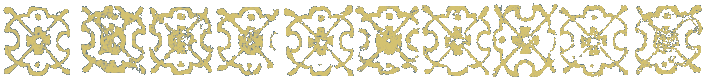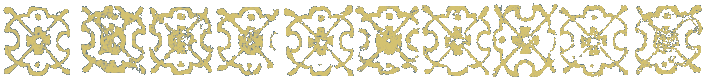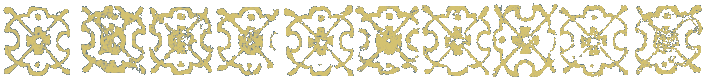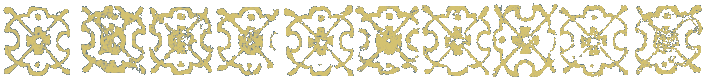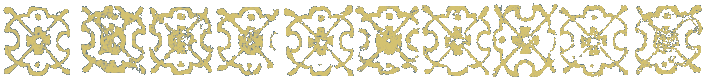ITINÉRANCES MUSICALES ENTRE LE DUCHÉ DE SAVOIE ET PARIS
SOUS LES RÈGNES DE LOUIS XIV
ET VICTOR-AMÉDÉE II
Dans
les années 1980, je
jouais de la vielle à roue en Berry et les Provençaux m’appelaient «
Fanchon la vielleuse ». On disait à Paris que cette célèbre Fanchon
était savoyarde, je suis donc partie à sa recherche dans les Alpes.
Mais je n’y ai trouvé aucune trace d’elle, ni dans la mémoire des
habitants, ni dans les archives que j’ai consultées.
C’est dans les
bibliothèques de Paris, que j’ai pu avoir accès à divers documents qui
m’ont permis de raconter son histoire dans l’ouvrage intitulé Fanchon
la vielleuse dans les rues de Paris. Il m’a semblé
alors que pour connaître les personnes qui se sont déplacées, il vaut
mieux aller chercher où elles se sont fixées, plutôt que dans
celui dont elles étaient originaires.
Pourtant,
un nombre assez
important de vielles a été retrouvé dans certains villages des Alpes
méridionales et mon père, né en 1907 se souvenait très bien que
c’étaient des montagnards, alors appelés « gavots », qui descendaient
sur la Côte pour mendier en jouant de la vielle.
Notre
famille vivait
en Pays de Grasse et, pour ma part, je constatais dans les années
1950-1960 que mes amis d’école avaient bien souvent des noms à
consonance transalpine. Évidemment, le comté de Nice était
géographiquement très proche de la Provence orientale et il a fait
partie pendant longtemps du duché de Savoie.
Un
jour, j’ai découvert
qu’un de mes ancêtres avait été colporteur et j’ai décidé d’aller voir
sur place les contrées qu’il avait dû traverser pendant des années. Il
s’agissait du versant alpin occidental, resté français. Mais ce
Jean-Joseph Sciaud
était aussi allé à Gênes.
En
fait, les Alpes
n’étaient pas une barrière infranchissable, bien au contraire. Pendant
des siècles, des habitants du versant italien, et donc des Savoyards,
sont venus chercher du travail dans les plaines et sur la Côte.
Le
phénomène semble ne s’être arrêté qu’avec la guerre de 1940. Lorsque
les frontières se sont fermées, ceux qui étaient côté français s’y sont
fixés.
Dans
l’imagerie populaire
est restée l’idée qu’un « savoyard » était un petit ramoneur… Ces
enfants voyageaient dans toute l’Europe. De nos jours on sait d’eux
qu’ils étaient aussi colporteurs, montreurs de lanterne magique et
amusaient le peuple avec des marionnettes qu’ils faisaient danser au
son de la vielle ou de tout autre instrument mécanique comme la
merlinette par exemple.
Ce phénomène a duré tout le long du XIXe
siècle. Il m’a paru évident qu’il devait avoir des origines dans les
siècles précédents, et mes recherches m’ont menée au siècle des
Lumières et même jusqu’au XVIIe
siècle.
J’ai
l’habitude d’aborder un
sujet historique par la musique. En l’occurrence, d’autres, avant moi,
ont fait une étude très poussée et fort intéressante sur l’influence
des musiciens et artistes italiens à la Cour de France : je pense entre
autre à l’ouvrage édité par le Centre de Musique Baroque de Versailles
en 2004 en l’honneur du très important travail de recherche effectué
par
Jean
Lionnet
lors de son séjour
à Rome :
Les
Italiens à la cour de France de Marie de Médicis au régent Philippe
d’Orléans.
Ma
spécialité étant les musiques populaires et de salons des XVIIe et
XVIIIe
siècles c’est par elles que je vais aborder mon sujet, venant compléter
j’espère, toutes ces études sur les compositeurs italiens à Paris. Nous
allons donc nous situer entre 1640 et 1750 pour étudier les rapports
tant historiques que musicaux entre le duché de Savoie et Paris.
Il est
bien difficile de
préciser les frontières de ce duché étant donné toutes les guerres qui
les ont régulièrement déplacées en si peu de temps. Voici une carte qui
m’a paru être assez lisible. On y voit que ce duché englobe en grande
partie le massif des Alpes.
En
dépouillant les sources à
Paris j’ai bien évidemment constaté une présence et un rôle très
important des institutions culturelles émanant des Italiens : Théâtre
Italien, Comédie Italienne…
Dans
les partitions beaucoup
d’œuvres sont dites « dans le goût italien ». Mais ces Italiens, de
quelle région de la péninsule venaient-ils exactement ? Ce n’est pas
toujours facile à déterminer…
Par
contre les échanges
entre le royaume de France et le duché sont nombreux et attestés.
Citons quelques cas :
- Le
comte Filippo d'Aglié
(1604-1667) courtisan, diplomate, poète, chorégraphe et compositeur fut
au service du cardinal Maurice de Savoie, puis du duc Charles Emmanuel 1er
(1630-1637) et enfin de la duchesse Christine. Après avoir passé quatre
ans à Paris sous le règne de Louis XIII, une fois rentré à la cour de
Turin il devint l’auteur de divertissements et de ballets - avec une
chorégraphie dans le style français – mais aussi de spectacles sur
l'eau et de carrousels qu’il adapta aux goûts des princes de la cour de
Savoie.
- Paul La
Pierre (1612-après
1690) originaire d’Avignon, violoniste, maître à danser et compositeur
a mené sa carrière essentiellement à la cour de Turin où il fut maître
à danser de Charles Emmanuel II.
- Ou
encore Marc Roger Normand
(1663-1734), cousin de François Couperin, a travaillé à la cour de
Turin à partir de 1688. On relève d’ailleurs que quelques années plus
tard, François Couperin écrira ses premières sonates "à l'italienne"
qui seront ensuite intégrées dans Les Nations en
1726.

Dans
les salons parisiens,
on parodie des œuvres italiennes comme le compositeur [Philippe]
Du Gué qui publie vers 1735 des sonates
dans le goût italien.
Elles étaient vendues entre
autres à Paris chez Chédeville l'aîné.
Contrairement à la musique française, le nom des mouvements y est noté
en italien.
N’oublions pas aussi que Nicolas Chédeville, dit le cadet,
publie vers 1740 des pantomimes italiennes pour
les instruments alors à la mode dans les salons parisiens comme la
musette, la vielle.... et une adaptation pour ces mêmes instruments à
bourdons, des concertos d’Antonio Vivaldi qu’il nommera Le
Printemps ou les saisons amusantes.
On
peut se demander si les
termes « italien », « savoyard » avaient une signification bien précise
pour les Parisiens, que ce soit pour le peuple ou les notables. En tout
état de cause, on trouve bien souvent des mélodies portant comme titre la
savoyarde, les savoyards, jouées et rééditées
tout au long du XVIIIe
siècle, et conservant leur titre, tout en servant bien souvent de
support musical à des chorégraphies de contredanses.
Où
pouvait-on entendre
toutes ces œuvres dont nous parlons ? Un peu partout. Il ne faut pas
croire que les milieux sociaux étaient cloisonnés. Les notables, autant
que le peuple, écoutaient les dernières nouvelles dans les rues, les
cabarets, sur les boulevards grâce aux faiseurs de chansons qui
jouaient en quelque sorte le rôle de la presse pour les non-lecteurs. À
l’inverse, les bourgeois faisaient entrer dans leur salon des musiciens
de rues, pour divertir leurs amis, d'ailleurs ils faisaient de même à
l’égard des
musiciens et compositeurs encore peu connus, pour qu’ils puissent être
programmés, par la suite, au Concert Spirituel.
Nous
allons nous-mêmes nous
promener des rues, aux salons, et à la Cour.
Les rues
Commençons
par la rue avec
un personnage bien typé Philippot le Savoyard
, se faisant aussi appelé le capitaine
. Il avait l’habitude de s’installer sur le Pont Neuf mais parcourait
aussi tout le royaume de France. On sait de lui que son père était
lui-même chanteur de rues. Arrivaient-ils réellement de la Savoie ?
Rien n’est sûr.
Ce qui est certain c’est que Philippot qui a dû naître
vers 1600 était devenu aveugle à cause d’une vie de débauche, comme il
aimait à le raconter. Sa voix puissante, ses gestes burlesques et ses
mimiques interpellaient les passants ; il était accompagné d’enfants ou
d’une
femme pour le guider et lui lire ou transcrire ses chansons.
Ses
cahiers ont été publiés par l’éditeur Ballard dans les années 1640 mais
on parle aussi d’autres recueils comme : Recueil
général des chansons du capitaine Savoyard chantées par lui seul dans
Paris en 1645. Et aussi, Recueil
nouveau des chansons du Savoyard chantées par lui seul dans Paris en
1656 ; réimpression en 1661 et 1665.
Cette
dernière réimpression a été publiée de nouveau par l’éditeur parisien
Jules Gay en 1862 avec un avant-propos du bibliophile Achille
Percheron. Philippot les vendaient aussi lui-même.
Nous
tenons ces informations
du récit que nous a fait Charles Coypeau d’Assoucy dans ses aventures
qu’il a publiées chez Claude Audinet en 1677.
D’Assoucy
(écrit aussi
Dassoucy), lors d’un de ses voyages vers le duché de Savoie, raconte
avec mille détails sa rencontre avec le Savoyard qu’il nous mentionne
comme étant aveugle. C’est après une rixe dans un lieu populaire (comme
une auberge) qu’elle a lieu, d’Assoucy ayant été secouru par deux
capucins et le Savoyard. Ce dernier demande alors à d’Assoucy de « lui
faire dire une chanson » et il le complimente.
Ils se
trouvent des
points communs : celui d’aller « chanter publiquement par les portes ».
Le Savoyard, « après avoir tiré de sa poche un petit livre couvert de
papier bleu…. ils unirent tous les deux leur voix ….et tous deux ils
chantèrent ces agréables chansons ; cela dans la plus parfaite bonne
humeur. »
D’Assoucy complimente le Savoyard par ces termes : « [Vous]
avez bien raison d’appeler la chanson pitoyable et récréative, puisque
tout ensemble elle nous a si bien fait rire et si bien pleurer… elle a
défié les plus beaux esprits du temps de la pouvoir jamais imiter et
bien que ces rimes fussent triviales et ses expressions vulgaires….
elles étaient infiniment préférables à toutes les rimes plates et
glacées de tant de poètes morfondus ».
D’Assoucy
ne voulant pas
perdre la trace d’un tel homme lui demande son nom et le lieu où il
tient son Parnasse. Et dans un élan de sympathie, il lui offre à manger
et à boire et les deux hommes s’échangent un recueil de leurs chansons.
Le Savoyard refuse celui de d’Assoucy prétendant que son auditoire
n’est pas à même d’apprécier ce genre musical. Et nous apprenons que le
père du Savoyard chantait lui des œuvres de Pierre Guédron
[compositeur, chantre et luthiste, maître de musique du roi Louis
XIII], et que Philippot regrettait que le style musical ait tellement
changé depuis, préférant les vieilles chansons aux motets alors en
vogue.
Mais
qui était ce Sieur
D’Assoucy ?
C’est
dans un autre de ses
récits intitulé les aventures burlesques de
d’Assoucy par lui-même et publié la même année
(1677, année de sa mort) que nous apprenons que son auteur s’appelait
Charles Coypeau d’Assoucy.
Il semblait être de condition sociale plus
élevée que le Savoyard même s’il nous rapporte ses problèmes constants
d’argent, liés à son vice : celui du jeu. Il se considérait
d’extraction noble. Sa mère était chanteuse et luthiste, d’origine
lorraine et son père, avocat au Parlement de Paris, était bourguignon.
Parmi ses ancêtres figurait un célèbre fabricant de violon à Crémone.
Ses parents s’étant séparés assez vite, le petit Charles avait commencé
très tôt à traîner dans les rues, ce qui lui avait permis de découvrir
ce monde de chanteurs et musiciens ambulants.
Non content de courir les
rues de la capitale, il était parti dans d’autres villes du Royaume au
service de différentes personnes, comme une abbesse à Corbeil, puis un
autre notable à Calais. Mais plusieurs de ses voyages avaient eu pour
destination le duché de Savoye.
Comme
pour d’autres
personnages hauts en couleur, une véritable légende, comme les aimaient
les auteurs du XIXe
siècle, a été bâtie sur d’Assoucy et sa rencontre avec le Savoyard.
Paul Lacroix, par exemple nous a laissé un ouvrage dans ce sens, édité
par C. Delagrave à la charnière des XVIIIe et
XIXe
siècles Les hauts faits de Charles d'Assoucy ; Une
famille de musiciens. Mais dans sa préface est
mentionné que ce récit faisait partie des histoires que l’on racontait
aux enfants.
Cette
rencontre originale
entre un chanteur populaire qui se disait savoyard et un compositeur
luthiste a bien eu lieu. En effet, d’Assoucy a effectué des
voyages lointains, comme
beaucoup de musiciens souhaitant obtenir la gloire, et notamment à
plusieurs reprises jusqu’au duché de Savoie.
Malgré sa haute naissance il a plus vécu d’après ses dires même, sur
les routes et dans les cabarets durant ses voyages que dans les lieux
de divertissement de la capitale.
Cet
exemple assez bien
documenté, nous semble particulièrement intéressant pour relier le
monde des musiciens de rue à celui des salons et celui de la vie
culturelle parisienne à celui de la cour de la Reine Christine de
France à Turin dans les années 1640. La destination première des
voyages de d’Assoucy était le duché de Savoie.
Mais ses aventures sur
la route l’ont bien souvent détourné, du moins provisoirement, de la
voie la plus directe. Il est bien fier de nous expliquer que sa bonne
réputation de musicien/poète le précédait à chacune de ses étapes.
Lorsqu’après être passé par la Bourgogne, Lyon, Pézenas, Béziers,
Narbonne, Avignon, Marseille, Antibes, Nice, Monaco, il finit par
arriver à Turin où, lui et son chanteur Pierrotin, furent très bien
accueillis par les Altesses Royales de la cour de Christine de France.
C’est dans les salons de la résidence secondaire de cette dernière que
les réjouissances avaient lieu au « Palais de la Vigne », sur les rives
du Pô. D’Assoucy dédicace à la duchesse Christine des chansons comme
celle-ci après le décès de son époux Victor-Amédée 1er,
époque où elle devient régente du duché. Chanson publiée par l’éditeur
Ballard en 1653.
Divins
soleils, beaux yeux, célestes phares/Voyez ici trois malheureux
Icares/
Trois cœurs mourant d’une atteinte mortelle/Trois papillons
brûlés à la chandelle.
Unique
espoir où ma douleur aspire/Finis les mots dont mon âme soupire/
Dedans
mon sang, o mort ! Trempe tes armes/Abandonnant la princesse des
charmes…
Il
faut dire que depuis bien
longtemps, ce duché était tourné vers les autres cours princières en ce
qui concerne les arts. Vers la fin du XVIe
siècle, le prince Thomas, après avoir longtemps servi le royaume
d’Espagne dans les guerres de Flandres, avait vu une occasion de se
lier avec les grands maîtres de ce pays et avait acquis un grand nombre
de leurs œuvres. Son frère, le cardinal Maurice de Savoie,
préférait les artistes italiens et Christine de France continua à
développer les arts dans son palais de Turin.
Les salons
Au
siècle suivant, nous
trouvons une œuvre musicale d’un certain Venceslas Spourni, qui écrit
des sonates pour deux dessus et basse, qu’il dédie à son mécène le
prince de Carignan et dont voici le titre original :
VI
SONATES/POUR une Musette ou Vielle,/Violon et basse/Par/VENCESLAS
SPOURNI/Compositeur de Feu S.A.S./Monseigneur. LE PRINCE DE CARIGNAN
Dans
son ouvrage La
Pouplinière et la musique de chambre au XVIIIe
siècle publié en 1913, l’historien de la musique,
Georges Cucuel nous apprend que le Prince de Carignan serait
Victor-Amédée Joseph de Savoie, un passionné de théâtre et de musique.
Il fut d’ailleurs inspecteur de l’Opéra de Paris à partir de 1730
jusqu’à son décès en 1741 ; période durant laquelle il donnait des
concerts dominicaux. Il se serait marié avec une fille naturelle de
Victor-Amédée II, Marie Victoire France Carignan (1690-1766).
Le couple
fortement endetté, était parti s’installer à Paris en 1718 sous la
Régence de Philippe d’Orléans. En 1730 Louis XV avait nommé le Prince
de Carignan « Intendant des Menus-Plaisirs ». Installé à l’hôtel de
Soissons il y organisait ses propres concerts.
Georges Cucuel nous dit
que c’est à cette occasion que le Prince de Carignan a dû faire la
connaissance de Monsieur
Le Riche de la Pouplinière, fermier général et
ordonnateur de fêtes musicales,
avec qui il entretint des relations parfois houleuses.
Le
Prince de Carignan est
décédé le 4 Avril 1741, ce qui explique la mention Compositeur
de Feu S.A.S./Monseigneur sur la page de titre des
sonates de Venceslas Spourni. L’exemplaire de ces sonates conservé à La
Bibliothèque Nationale de France mentionne bien un privilège du Roi
mais sans date. François Lesure dans son catalogue
de la musique imprimée avant 1800 conservée dans les bibliothèques
publiques de Paris mentionne la date circa 1741.
Des salons à la Cour, le chemin est bien court.
Nous
avons plusieurs
exemples qui nous montrent que les représentations musicales sont
parfois à tonalité savoyarde.
Examinons
tout d’abord une
œuvre d’un certain Monsieur De Hesse conservée à la bibliothèque de
l’Arsenal à Paris, à laquelle la Bibliothèque Nationale de France a
donné comme titre [Argument de]Le ballet des
savoyards/de la composition de Monsieur De Hesse.
On peut dater ce ballet de 1749. Jean-Baptiste de Hesse (1705-1779)
était connu comme comédien, chorégraphe, danseur et maître de ballet de
la Comédie Italienne de 1738 à 1757.
Au dépouillement, nous nous
apercevons que ce cahier est monté à partir de feuillets édités au XVIIIe
siècle et réunis entre eux. D’après la bibliothèque, cet ouvrage serait
un don d’un certain G. Douay ; serait-ce Georges Douay compositeur,
décédé en 1919 ?
On y
lit :
Le
ballet des Savoyards de la composition de Monsieur De Hesse. Ce ballet,
en partie pantomime, dont le succès prodigieux se soutient encore au
Théâtre Italien, a été donné pour la première fois le Samedi 30 Août
1749. Mademoiselle Favart, alors dans son premier début, y fit
connaître ses talents pour la danse et le vaudeville.
Celui
qu’elle y chante est une ronde dans le goût des porteuses de marmotte,
dont M. Favart est l’auteur…
…
La
mode de la musique italienne a jeté Mademoiselle Favart dans une
nouvelle carrière qui ne lui fait pas moins d’honneur, et où le public
doit lui tenir compte du travail assidu qu’elle est maintenant obligée
de joindre aux dons de la nature.
Nous
croyons qu’on nous sera grès d’ajouter ici, tant la ronde dont nous
venons de parler, que les différents airs ou Vaudevilles de la
composition de Mr Favart, qui ont été chantés à la Cour et à Paris aux
différentes reprises de ce ballet, par les demoiselles Favart et de
Hesse, et le sieur Chanville.
Nous
savons que Mademoiselle
Favart, Mademoiselle de Hesse et Monsieur Chanville étaient des acteurs
du milieu du XVIIIe
siècle qui travaillaient pour Monsieur Favart père au Théâtre Italien.
La
ronde commence dans ces
termes :
Mon
paire, aussi ma maire/M’ont voulu
marida/Derida/https://centrepatrimoineimmateriel.fr/histoires/Savoyards.html
A c’ta saison dernière/Avec
un
avocat/Hé ! coussi coussa,/
A c’t heure-là,/Le pauvre amant que voilà !
L’auteure
n’avait pas l’air
bien satisfaite de son mari mais heureusement passa un savoyard :
Par-là,
par aventure,/Passa mon Savoya,/Derida ;/
Il pansa ma blessure, et me
faisa sauta/Hé ! coussi coussa,/
A c’t heure-là,/Sauta la Catarina.
La
reproduction de ce ballet
que nous possédons à ce jour ne comporte aucune mélodie mais nous avons
pu la retrouver dans notre base de données Cythère
. Elle porte aussi le nom de « savoyarde » quand Esprit Philippe
Chédeville la transcrit, dans deux de ses recueils édités dans les
mêmes années, comme « vaudeville » ou « contredanse ». Devenue un
timbre dans une autre source, elle est alors mentionnée sous le titre Dans
un bois solitaire où Vénus inventa dirida.
Un
autre vaudeville suit. En
voici les premières paroles
Habitants
de ces montagnes,/N’attendez point les frimas ; /
Déjà Flore, dans nos
campagnes,/Languit et perd ses appas/
Les jeux vont quitter nos asiles
;/Mais en France, au sein des villes,/
Ils voleront sur vos pas ;/Partez
pour ces heureux climats ; /
On y voit régner l’allégresse…
Monsieur
Chanville est
déguisé en père savoyard et chante :
Ne
regrettons point nos champs,/Fuyons la triste indigence,/
En France, on trouve en tout temps/Les plaisirs et l’abondance,/
Les peuples y sont contents,/Tout est pour eux, jouissance./
Allons tous en France, mes enfants,/Allons en France,/
Nous n’avons rien apprêté/Pour faire notre voyage ;/
Nos talents, notre gaîté,/Nous tiennent lieu d’équipage/
Par des danses, par des chants,/Nous payons notre dépense…
… La
gaîté confond les rangs,/Dans ce pays de cocagne ;/
On y reçoit bien les
gens/Que le plaisir accompagne,/
On y trouve chez les grands,/Doux
accueil sans suffisance…
…
C’est
là que les avocats/D’une gaillarde éloquence/
Par mille traits
délicats,/Réjouissent l’audience ;/
Les Abbés y sont galants…
…
La
grand’ville de Paris/Sera notre résidence/
C’est là que tous les
esprits/Sont gais avec pétulance ; /
On y marche en fredonnant ; /On s’y
promène en cadence…
Vu son
succès remporté à la
ville, le ballet a été redonné devant la cour de France le 20 mars 1754
sur le théâtre de Versailles.
Déjà,
en 1700 la Savoie et
ses habitants étaient à la mode dans la capitale française tant dans
les rues qu’à la Cour puisque nous avons retrouvé un recueil intitulé Mascarade
des savoyards. Il est conservé à la Bibliothèque
Nationale de France.
En
deuxième page, on peut
prendre connaissance de la liste des acteurs de cette pièce de théâtre.
On y
mentionne à la fois le
nom des acteurs et leur rôle.
L’acteur
principal Galanty,
vieux savoyard conduisant sa famille Arlequin …
…
Quatre
Savoyards portans des Boëtes de curiositez …
…
Quatre
jeunes Savoyards, dansans….
SAVOYARDS,
joüans des Instruments.
Parmi
les sept
instrumentistes mentionnés – déguisés en savoyards, semble-t-il – nous
trouvons quatre membres de la famille Danican-Philidor soit deux au
hautbois, un au basson et un à la vielle : Anne, fils de Philidor
l’aîné, l’auteur de la musique de cette pièce.
Un
texte et des chœurs se
répondent sous la forme de quatre entrées. Aucune musique n’est notée
dans l’exemplaire que nous décrivons, et pourtant, sur la page de
titre, il est mentionné que cette mascarade est mise en musique par
Monsieur Philidor l’aîné et qu’elle fut représentée devant le roi à
Marly.
Au
dépouillement, nous y
trouvons une seule mention de musique : à la troisième entrée, Première
chaconne. Mais le document en main semble avoir
été reconstitué ultérieurement car monté sur des pages en fond bleu,
comme d’ailleurs l’œuvre de De Hesse dont nous venons de parler.
En
feuilletant le recueil intitulé SUITE DES
DANCES… Qui se jouent ordinairement à tous les Bals chez le Roy,
recueillis, mises en ordre & composés la plus grande partie ;
par M. Philidor l’aîné, Ordinaire de la Musique du Roy & Garde
de tous les Livres de sa Bibliothèque de Musique l’An 1712,
nous
avons retrouvé la chaconne qui porte comme nom La
Chaconne des Savoyards à Marly par Philidor l’aisné.
Dans
ce même recueil a été aussi transcrit La Savoye que
nous retrouvons comme contredanse et qui est présente dans des recueils
manuscrits d’airs transposés pour la vielle, toujours à la même époque.
Lorsque
la vielle est
devenue instrument de salon, sous la Régence et le règne de Louis XV,
représentait-elle déjà les petits musiciens savoyards jouant dans les
rues ?
Dans les années 1670, les fameux vielleux La Roze et Janot
dont
parle Antoine Terrasson dans sa dissertation
historique sur la vielle – dans les années 1740
– étaient-ils d’origine savoyarde ?
Étaient-ils vraiment des musiciens
de rue, quand on imagine les tenues que devait porter Charles Coypeau
d’Assoucy lors de ses déplacements sur les routes ?
À la
lecture de ses
compositions, on ne peut pas considérer celui-ci comme un musicien
populaire ! Toujours d’après Antoine Terrasson, La Roze jouait des
menuets, des entrées… et chantait des vaudevilles en s’accompagnant à
la vielle. D’Assoucy faisait de même, quelques années plus tôt, avec
d’autres instruments convenant aussi à un accompagnement musical : le
luth, le théorbe…
Quant
à
Janot lui, il jouait
sur sa vielle des contredanses mais aussi des airs d’opéras de Lully
comme « la descente de Mars ». Nous sommes donc après 1675, date de
création de l’opéra Thésée
par Jean-Baptiste Lully qui contient cet
air. Tout ce répertoire n’a rien à voir avec les musiques de rues même
si on les entendait dans les lieux de divertissements parisiens.
Si
nous remontons encore
dans le temps avec Jean-Baptiste Lully, nous nous apercevons que dans
ses deux ballets datés de 1661 et 1662, on trouve un air pour des
vielleux.
Dans Le ballet de l’Impatience
, donné au Louvre pour célébrer la fin de la guerre entre la France et
l'Espagne où Louis XIV danse dans le rôle du "grand amant" figure un Air
pour les aveugles jouant de la vielle.
Quant au ballet
Ercole Amante ou l’Hercule
amoureux , commandé pour les noces de Louis XIV
et Marie-Thérèse, infante d’Espagne qui ont eu lieu en 1659, on y
trouve un air intitulé Pour les pèlerins jouant de
la vielle qui est suivi d’un concert
de Guittairne pour Mercure dieu des charlatans .
La distribution de l’opéra était franco italienne et faisait appel à
des castrats italiens dont Giuseppe Chiarini, qui, lui en l’occurrence
était savoyard et membre à cette période là, du cabinet italien de la
cour de France.
Ajoutons
que dans le
Ballet du temps, écrit en 1654 et dansé par le
Roi, la première entrée est intitulé les colporteurs.
Comme
on peut le constater
même avant « l’âge d’or » de la vielle à Paris – terme que nous
employons de nos jours – celle-ci n’était pas seulement dans les mains
des mendiants. D’ailleurs elle est représentée du temps de
Jean-Baptiste Lully dans des décors de pages de titres parmi d’autres
instruments les plus reconnus à l’époque.
Sur
cette iconographie on
peut juste remarquer que la vielle a encore l’ancienne forme (avant les
transformations organologiques de la famille Bâton, à partir de 1716).
Anne Philidor a dû jouer la chaconne dans la mascarade
des Savoyards que nous avons vue plus haut sur une
vielle de ce type.
Mais
tous ces faits
historiques sont-ils restés longtemps dans la mémoire des Savoyards ?
Oui semble-t-il, puisque lorsque Julien Tiersot, bibliothécaire du
Conservatoire de Paris et originaire de l’Ain, collecte des chansons
traditionnelles dans certaines vallées alpines à la toute fin du XIXe
siècle, on lui en chante, comme par exemple :
Les
Espagnols en Italie
L’air
employé est un timbre
fort ancien sur les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous le
trouvons sous le titre Les Pèlerins mais
aussi Nous voyageons parmi le monde et
il convient très bien à l’histoire de cette chanson. Quant aux paroles
: c’est une vraie leçon d’histoire nous relatant la guerre dans les
Alpes entre les cours princières.
Voici
quelques explications
historiques pour mieux en comprendre le sens.
…Et nous
sommes pis que Réformés, tous maudits du Saint-Père …
Au
moment de la Révocation
de l’Édit de Nantes en 1685, Louis XIV avait demandé à Victor Amédée II
de s’opposer au passage des huguenots venant du sud de la France, mais
celui-ci, pourtant catholique, non seulement les avait laissé passer
mais les tolérait dans ses vallées.
Dom
Philippe [Philippe V,
roi d’Espagne], devant intervenir dans le conflit, commence une
expédition par mer, mais, ayant échoué à cause de la flotte anglaise
stationnée en Méditerranée, il écoute les conseils de sa mère et repart
quelques mois plus tard par terre :
En
partant, sa mère dolente, lui dit : mon fils prenez votre route par
terre, C’est mon avis, tant mieux, maman, je passerais chez mon
beau-père, outre cela j’éviterai la flotte d’Angleterre.
Il faut
préciser que Dom
Philippe était marié, en deuxième noce à Marie Louise de Gabrielle de
Savoie, fille de Duc Victor Amédée II.
Une
autre chanson est restée
dans la mémoire collective. Julien Tiersot la mentionne comme « chanson
historique » : Notre duc mal à son aise.
Son
refrain :
Ramonez-ci,
ramonez-là,… La cheminée du haut en bas
C’est
sous ce titre que nous
retrouvons l’air en tant que timbre dans les Parodies
du Nouveau Théâtre Italien dans les années
1731-1738 et dans les différentes publications du Théâtre de la Foire
jusqu’en 1810.
Ici,
nous sommes en 1703.
Les Parisiens protestent contre les indigents savoyards et ragent
contre le duc de Savoie le considérant comme un ingrat.
Ramoneurs
que l’indigence presse de venir en France, restez dans vos froids
climats. Nous avons au cœur la rage contre votre duc volage, c’est le
plus grand des ingrats.
On
apprend que Victor Amédée
a pris les armes contre son gendre Philippe V. Souhaitant conquérir
Gênes,
il s’allie au
premier venu, et ayant échoué, on le traite de « roi de la lune ». Son
allié le portugais Bragance et lui-même seraient capables de devenir
protestants pour arriver à leur fin.
Ces
deux chansons satiriques
pouvaient être entendues sur le Pont Neuf, lieu si prisé des Parisiens
pour connaître les dernières nouvelles et les colporter.
Julien
Tiersot mentionne
aussi « Jacotin », une autre chanson restée en savoyard sur le thème de
Noël. Il l’a recueillie non pas dans la mémoire collective mais dans un
recueil édité en 1555, conservé à la bibliothèque Mazarine à Paris,
sous le titre Noelz
et Chansons nouvellement composez tant en vulgaire
francoys que savoysien, dict patois par Nicolas Martin.
Traduction de
Julien Tiersot, en collaboration avec
André
Devaux :
En voici quelques extraits :
Jacotin/Gringotin/Un
noe fallot/Accordin/Et chantin/Tuyt quatroz en un
flot.
Loz
chantar prin ey lo diraz
Margot/Et la tenour ly pittiot Perotin /L’aultaz contrantaz mon compare
Janot/Per bondonnar, ie bondonneray bin
Noz
le
trouaron asetta sur
un plot/Un viou bon hommoz essuyan un pattin/Per loz pupu charfar et
tenir chault/Quand de sa mare leysserit lu tetin
Mon
compagnon saioz, discret
et cault,/Apre liaueir denna un agneillin,/Di à Colin : « Prend le ba
un escot/Et per dancyer tochiz loz taborin »
Lanuz
et
lob o ne furon pa
si glot/Qua fare honour a Dioz ne fussian enclin,/Et on leyssiaz de
migier un fagot/Per regardar luz petiot enfantin
Loz
Rey
ply sagoz que voz ne
noz et tot,/Lion presenta et denna prou de bin,/Dou lun esteit Gaspard,
latroz Melchiot,/Et Baltasard semblabloz a un mourin
Sadevoz
quey a parlar per
escot ?/Ey loz noz fault craindre et amar bin,/Et son coman fare, ey
net pas sot,/Se noz volin parady a la fin.
Jacotin/fredonnons/un
Noël plaisant/Accordons nous/ et chantons/ Tous
quatre d’un même mouvement
La
voix
aiguë, Margot la
dira /et le ténor, le petit Perrotin/la haute-contre, mon compère
Jeannot/pour le bourdon, je bourdonnerai bien.
Là
nous
trouvâmes assis sur
un morceau de bois/un vieux bonhomme essuyant un chiffon/pour
réchauffer le poupon et le tenir au chaud/quand il laisserait le sein
de sa mère.
Mon
compagnon sage, discret
et prudent/après lui avoir donné un petit agneau/dit Colin « prends
là-bas une baguette/et touche du tambourin pour danser. »
L’âne
et
le bœuf ne furent
pas aussi gloutons/qu’ils ne fussent prêts à rendre hommage à Dieu/Ils
ont cessé de manger une botte de foin/pour regarder le petit enfant.
Les
rois
plus sages que
vous, et nous et tous/lui ont présenté et donné assez de richesses/L’un
était Gaspard, l’autre Melchior, et Balthasar, semblable à un maure.
Savez
vous ce que nous
devons dire pour notre part ?/Il nous faut le craindre et l’aimer
bien/et faire son commandement : ce n’est pas un sot/si nous voulons le
paradis à la fin.


À part
des
chansons, que
reste-t-il dans la tradition alpine concernant cette époque là ?
La lanterne magique,
puisqu’on voit dans les nombreuses iconographies du XIXe
siècle des ambulants savoyards partir sur les chemins, soit en famille,
soit en bande d’enfants avec une boîte de lanterne sur le dos. Comme
cette famille sur ce tableau daté de 1809.
Mais
cette lanterne
existait
dans les pays du Nord depuis le XVIe
siècle. Elle est devenue magique parce qu’on la perfectionna peu à peu
en permettant de faire bouger plusieurs images à la fois. Effet qui
pouvait la rendre aux yeux du public, magique.
<---
Voici une scène représentant
des charlatans attirant le public sur la place de la Concorde à Paris à
la charnière des XVIIIe
et XIXe
siècles (tableau de François-Frédéric Lemot).
Enfin
l’existence, encore
vers la fin du XIXe
siècle d’un instrument traditionnel alpin : la vielle à roue. Ces deux
survivances sont souvent associées durant tout le XIXe
siècle.
--->
D’après ses descendants,
Giovanni Conte (né en 1847 à Coni et mort en 1933) était un véritable
homme orchestre qui, on le voit sur la carte postale restée en notre
possession, voyageait comme Philippot le Savoyard, accompagné d’un
enfant – le sien d’après sa famille – attirant le public avec divers
instruments de son temps dont une vielle.
D’autres
récits, comme ce
texte daté de 1840, sont nettement moins réalistes.
…Pour
les habitants d’Allos, les joueurs de vielle sont originaires des
vallées piémontaises : St Dalmas, la Stura, Maïra, Varaïta et on
raconte qu’à Saint Dalmas le Sauvage, il faut les voir, le jour de la
fête du patron, lorsque 200 vielles font retentir les voûtes de
l’église de la plus horrible musique qui ai jamais déchiré les oreilles
!
Je
pense, en tant que
vielleuse, que le nombre de vielles a été un peu exagéré par le
narrateur. Si on met seulement une ou deux vielles à jouer dans une
église, l’intensité sonore peut être comparée à un orchestre ; surtout
en cette première moitié du XIXe
siècle où, bien souvent les vielles de conception plus anciennes ont
été transformées afin de résonner plus que les vielles de salons de
l’époque baroque. L’église en question devait aussi avoir une
importante réverbération !
<---
A ces récits et témoignages,
nous devons ajouter les quelques vielles conservées dans les Préalpes
françaises. Elles sont toutes de fabrication rustique et pratiquement
toutes sont montées sur des corps de guitare, invention parisienne des
années 1716.
--->
Exceptons, celle de Giovanni
Conte, qui lui, est représenté avec une vielle montée sur une caisse
semblable aux caisses de luth :
Cette
vielle avait été
fabriquée par un luthier parisien Jean Louvet et datée de 1763. Parmi
tous ses voyages, dans quelle région Giovanni Conte avait-il pu
l’acquérir ?
Ses
descendants nous
apprennent qu’elle fut réparée dans le Bourbonnais à Jenzat par la
famille Pimpard en 1909 d’après l’étiquette apposée dans la vielle.
Étant donné la tradition de cette famille de luthier bourbonnais, il
est tout à fait normal que Giovanni Conte joue sur une vielle « ronde
», forme la plus courante dans cet atelier. Nous sommes loin de la
tradition de la vielle dans les Alpes.
Par
contre, il nous a paru
intéressant d’étudier les quelques iconographies de joueurs de vielle
représentés dans les rues de Paris et de comparer la forme de leur
vielle à celle des vielles conservées dans les Alpes.
Nous
en
avons choisi trois
parmi les plus connues :
• Une vielle dite
« guitare » mais dont le
chevillier a encore la
forme de celui des anciennes vielles dites
« trapézoïdales », jouée par un petit
vielleux.
Gravure du sculpteur dessinateur Edme Bouchardon (1698–1762)
• Une autre datant de la
deuxième moitié du XVIIIe
siècle.
La
caisse de sa vielle a une forme de guitare, avec le
chevillier finissant par une tête sculptée. On peut donc la considérer
comme postérieure à 1716.
Michel
Leclerc, par le
graveur
François Robert Ingouf
(1747-1812)
Leclerc
était un nom si répandu au XVIII
e
siècle à Paris ! Comment être sûr de son identité ? Nous possédons
encore
un manuscrit de poèmes dont un des auteurs serait un certain
Michel Leclerc et une date est mentionnée pour ce recueil : 1701-1725.
Mais, est-ce lui ?
• Enfin celle du vielleux
du Pont Neuf d’Augustin de Saint-Aubin (1736-1807)
Elle
est bien montée
sur une caisse de guitare avec une tête sculptée finissant le
chevillier comme beaucoup d’instruments à cordes de cette époque-là.
On
y voit aussi comme décor le liseré habituel (bicolore, intercalant
souvent ébène et ivoire) des vielles des luthiers les plus connus à
Paris sous le règne de Louis XV.
Par contre, elle semble n’avoir que
quatre cordes, contrairement à la facture instrumentale de vielle de ce
XVIIIe
siècle qui en comporte généralement six.
Conclusion
Après
l’étude menée par
Jean-Michel Guilcher sur les danses et particulièrement sur le rigodon
; celle de Georges Delarue sur les chansons populaires des Alpes et
bien d’autres chercheurs ; à la lumière de tout ce que j’ai trouvé à ce
jour, il apparaît d’une manière évidente que la tradition qui reste
dans certaines vallées des deux versants des Alpes au début du XXe
siècle découle de tous ces faits historiques et culturels.
D’autre
part, on a pu voir
qu’on ne peut pas cataloguer un répertoire musical de « populaire » ou
de « savant ». En ne remontant pas plus haut qu’au XVIIe
siècle, on s’aperçoit que tous ces milieux sociaux : les cours,
qu’elles soient de France ou d’ailleurs, comme celle de Turin, les
salons au travers de la petite noblesse et enfin le peuple, qui en
l’occurrence est surtout rural se mêlent constamment en s’enrichissant
mutuellement.
D’Assoucy,
courant les pays
pour présenter ses œuvres à la cour du duché de Savoie, devait être
considéré par ses contemporains comme un musicien de cabaret et non de
salons parisiens malgré la notoriété qu’il prétendait avoir dans toutes
les contrées qu’il traversait. Les chansons satiriques que l’on devait
entendre dans les rues de Paris comme Notre duc est
mal à son aise se moquaient des souverains. Les
compositeurs reconnus par la cour de France, comme Lully, Philidor
faisant figurer dans leurs opéras ou ballets un air pour des joueurs de
vielle, ne se souciaient pas de savoir si ces musiciens étaient
populaires ou pas, pourvu que ces œuvres destinées à Louis XIV et dans
lesquelles celui-ci participait comme danseur, aient du succès.
Je
pensais et j’avais écrit
qu’au XVIIIe
siècle la mode de la vielle s’était faite à partir des salons, mais
après l’étude de ce corpus musical commun aussi bien à un instrument
patrimonial qu’à une région précise, je constate que l’intérêt que la
cour de France a eu au XVIIe
siècle dans ces domaines, n’a pu qu’influencer les salons, qu’ils
soient
français ou d’autres pays d’Europe.
Notre
étude a débouché sur une
création scénique de notre ensemble
Les Enfans de Cythère en
2019
Françoise
Bois Poteur, août 2018